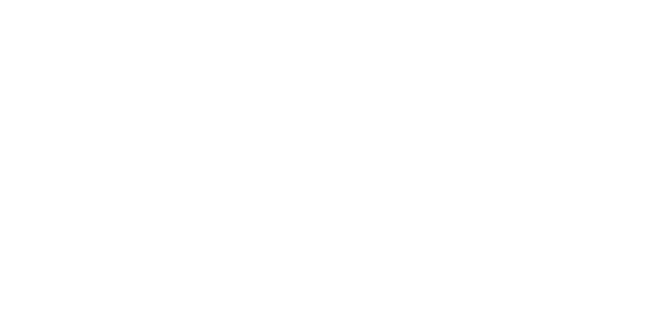Pourquoi le métier de correctrice professionnelle est-il encore méconnu ?
Le métier de correctrice professionnelle reste trop souvent invisible. Découvrez pourquoi il est pourtant essentiel à la qualité des textes.
Je suis une artisane de l’ombre. Je repère la faute que tout le monde a loupée, je rectifie la tournure maladroite, je redonne au texte sa cohérence et sa fluidité.
Alors pourquoi le métier de correctrice semble-t-il si marginal, alors qu’il est si indispensable ? Tentative de réponse.
1. Un métier discret… trop discret
Je ne suis pas sur le devant de la scène. Mon nom n’apparaît que rarement dans les remerciements, je ne signe pas les textes que j’ai pourtant enrichis.
Et c’est normal : mon rôle consiste justement à m’effacer. Une correction réussie ne se voit pas. Elle se ressent. Ma mission, c’est de faire en sorte que le texte soit limpide, sans que personne ne remarque mon passage. Cette discrétion, inhérente à mon métier, renforce malheureusement son invisibilité.
2. Une mission souvent mal comprise
Beaucoup réduisent le travail du correcteur à une simple chasse aux fautes d’orthographe. Or, corriger, c’est aussi :
- assurer la cohérence d’un texte,
- veiller à sa lisibilité,
- respecter les normes typographiques,
- harmoniser la mise en page,
- préserver (et parfois révéler) la voix de l’auteur.
Mais tout cela reste flou pour le grand public… et même pour certains professionnels.
3. L’illusion du « tout numérique »
Avec les correcteurs automatiques intégrés aux logiciels ou à des plateformes comme Prolexis ou Antidote, beaucoup pensent que le travail humain n’est plus nécessaire. Grave erreur. Ces outils sont utiles, mais ne comprennent ni la nuance, ni le ton, ni les intentions d’un auteur. Ils passent à côté du style, des glissements de sens, des contresens discrets…
Bref, ils ne remplacent pas un regard humain formé et expérimenté.
4. Une profession sans cadre officiel
Le métier de correcteur n’est pas encadré par un titre protégé. Il n’existe pas de diplôme obligatoire ni d’ordre professionnel.
Résultat : chacun peut s’installer comme correcteur, quel que soit son niveau. Cela nuit à la visibilité des correcteurs professionnels formés et sérieux, qui se retrouvent en concurrence avec des offres à très bas prix, parfois même des « corrections » réalisées par l’IA.
5. Une langue reléguée au second plan
Dans une société où tout va vite, on privilégie souvent le fond au détriment de la forme. On publie à la hâte. On veut faire passer un message sans trop se soucier de la manière. Pourtant… une coquille peut suffire à décrédibiliser un contenu.
Une faute peut entacher l’image d’une entreprise ou faire perdre en légitimité un auteur.
Une phrase bancale peut semer le doute chez le lecteur.
Le fond et la forme ne s’opposent pas : ils se servent mutuellement.
6. Une chance à saisir
La bonne nouvelle, c’est que les besoins en correction n’ont jamais été aussi nombreux : autoédition, newsletters d’entreprise, contenus en ligne, rapports annuels, posts de réseaux sociaux… Tous ces textes peuvent gagner en impact et en crédibilité grâce à l’intervention d’une correctrice professionnelle.
Notre métier n’a pas disparu. Il a juste changé de terrain.
En conclusion : un métier à redéfinir, pas à justifier
Le métier de correcteur n’est pas marginal. Il est essentiel, mais encore trop méconnu. Il incombe à nous, spécialistes de la langue, de faire connaître notre profession, de la rendre accessible et attrayante.
Et de rappeler qu’un deuxième regard s’avère nécessaire pour chaque texte marquant, chaque phrase percutante, et chaque livre qui restera longtemps en mémoire.
Vous êtes auteur·e, autoédité·e ou professionnel·le et vous cherchez une correction sérieuse et respectueuse de votre texte ? Découvrez toutes mes prestations.
À lire aussi : « Pourquoi corriger un livre prend du temps ? »
📬 Une question ? Un projet ? Contactez-moi, je vous répondrai avec plaisir.